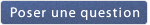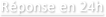Recompense et remboursement capital emprunté par a
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Madame, Monsieur,
Peut-être voudrez-vous bien répondre à mon interrogation sur la nature juridique d’un remboursement d’emprunt immobilier par l’assurance décès en régime de communauté légale, et, son incidence sur le montant des récompenses dues à la communauté , s’agissant d’un emprunt commun, juste avant mariage, pour le paiement d’un bien propre à l’époux survivant.
Dans la liquidation de communauté légale :
Pas de problème pour le capital remboursé pendant le mariage, l’époux survivant en doit récompense à la communauté selon l’article 1469 al 3
Mais en est-il de même pour le capital d’emprunt remboursé par l’assurance décès ?
-le notaire liquidateur me dit que oui, les primes d’assurances ayant été payées par la communauté, le capital remboursé directement à l’organisme prêteur par la compagnie d’assurance doit être assimilé à un paiement par la communauté. Il ouvre donc droit à récompense au profit de la communauté.
-un autre notaire me dit le contraire, du fait que le remboursement par l’assurance décès est postérieur à la dissolution de la communauté, et, du fait que le bénéficiaire de ce remboursement étant l’organisme prêteur, les sommes remboursées sont demeurées étrangères au patrimoine de la communauté légale. Il ne faut donc pas les inclure dans le calcul des récompenses dues par l’époux survivant à la communauté.
Ce second notaire se fonde sur les cassations :
Civ.1ère 1er décembre 1987 : Defresnois 1988 art 34229, n°37 p.538, G.Champenois et
Civ.1èere 14 décembre 2004, recueil Dalloz 2005 n° 8, p 545-546 notes de Monsieur le professeur Rémy CABRILLAC.
Mais ces cassations traitent de capital remboursé par une assurance invalidité et de l’art 1404 du C Civ. Ces cassations sont elles adaptées à mon cas où c’est une assurance décès qui intervient. Lequel des deux notaires à raison ?
Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées.
Peut-être voudrez-vous bien répondre à mon interrogation sur la nature juridique d’un remboursement d’emprunt immobilier par l’assurance décès en régime de communauté légale, et, son incidence sur le montant des récompenses dues à la communauté , s’agissant d’un emprunt commun, juste avant mariage, pour le paiement d’un bien propre à l’époux survivant.
Dans la liquidation de communauté légale :
Pas de problème pour le capital remboursé pendant le mariage, l’époux survivant en doit récompense à la communauté selon l’article 1469 al 3
Mais en est-il de même pour le capital d’emprunt remboursé par l’assurance décès ?
-le notaire liquidateur me dit que oui, les primes d’assurances ayant été payées par la communauté, le capital remboursé directement à l’organisme prêteur par la compagnie d’assurance doit être assimilé à un paiement par la communauté. Il ouvre donc droit à récompense au profit de la communauté.
-un autre notaire me dit le contraire, du fait que le remboursement par l’assurance décès est postérieur à la dissolution de la communauté, et, du fait que le bénéficiaire de ce remboursement étant l’organisme prêteur, les sommes remboursées sont demeurées étrangères au patrimoine de la communauté légale. Il ne faut donc pas les inclure dans le calcul des récompenses dues par l’époux survivant à la communauté.
Ce second notaire se fonde sur les cassations :
Civ.1ère 1er décembre 1987 : Defresnois 1988 art 34229, n°37 p.538, G.Champenois et
Civ.1èere 14 décembre 2004, recueil Dalloz 2005 n° 8, p 545-546 notes de Monsieur le professeur Rémy CABRILLAC.
Mais ces cassations traitent de capital remboursé par une assurance invalidité et de l’art 1404 du C Civ. Ces cassations sont elles adaptées à mon cas où c’est une assurance décès qui intervient. Lequel des deux notaires à raison ?
Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées.
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Bonjour monsieur,
De prime abord, il est logique de considérer que les décisions prises sur le fondement de l'assurance invalidité sont également applicables à l'assurance décès adossée par un contrat de crédit dans la mesure où juridiquement, ces deux indemnités ont le même objectif: Il s'agit de compenser la perte de revenu lié à la perte du conjoint et non de réparer un préjudice corporel.
Ce qui est étonnant en revanche, c'est que le second notaire a fourni des références qui donnent justement raison au premier notaire.
En effet, dans l'arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation considère que l'indemnité versée par l'assurance, dans la mesure où elle est destinée à compenser la perte de revenus lié à l'incapacité du conjoint, doit être assimilé à un substitut de revenus, et dès lors tombe en communauté.
Vous êtes donc obligé à récompense. Cet arrêt, s'il est en rupture avec la jurisprudence ancienne, se justifie néanmoins sur le plan juridique et n'a pas été démenti depuis.
Je me joins donc à l'avis du premier notaire liquidateur.
Je vous fais parvenir le commentaire de jurisprudence sur cet arrêt:
Bien cordialement.
De prime abord, il est logique de considérer que les décisions prises sur le fondement de l'assurance invalidité sont également applicables à l'assurance décès adossée par un contrat de crédit dans la mesure où juridiquement, ces deux indemnités ont le même objectif: Il s'agit de compenser la perte de revenu lié à la perte du conjoint et non de réparer un préjudice corporel.
Ce qui est étonnant en revanche, c'est que le second notaire a fourni des références qui donnent justement raison au premier notaire.
En effet, dans l'arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation considère que l'indemnité versée par l'assurance, dans la mesure où elle est destinée à compenser la perte de revenus lié à l'incapacité du conjoint, doit être assimilé à un substitut de revenus, et dès lors tombe en communauté.
Vous êtes donc obligé à récompense. Cet arrêt, s'il est en rupture avec la jurisprudence ancienne, se justifie néanmoins sur le plan juridique et n'a pas été démenti depuis.
Je me joins donc à l'avis du premier notaire liquidateur.
Je vous fais parvenir le commentaire de jurisprudence sur cet arrêt:
Citation :
La frontière entre biens communs et biens propres a priori clairement tracée par le code civil engendre pourtant un contentieux régulier, comme en témoigne récemment l'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2004. Deux époux mariés sous le régime de communauté légale concluent durant le mariage un prêt immobilier, le mari, tout comme son épouse d'ailleurs, ayant en outre souscrit une assurance invalidité garantissant le paiement des échéances de ce prêt. Le risque se réalisant du fait de l'insolvabilité du mari, l'assureur règle les échéances du prêt au prêteur bénéficiaire. Les deux époux divorçant, un litige naît sur la qualification des indemnités ainsi versées. Considérant que ces indemnités présentaient un caractère exclusivement personnel, la Cour d'appel d'Amiens les avait qualifiées de bien propre du mari dans un arrêt du 12 mars 2002, décision que censure la Cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2004.
Il faut observer de manière préliminaire que l'indemnité versée dans le cadre d'une assurance de chose n'est pas concernée par cette décision, sa nature propre ou commune découlant, par le mécanisme de la subrogation réelle, de la nature propre ou commune du bien assuré objet du sinistre. Etait ici en cause une assurance de personne, l'assurance invalidité, destinée à indemniser l'assuré suite à une invalidité dûment constatée. Cette assurance était en l'espèce adossée à un prêt de telle manière que l'invalidité d'un des époux entraînait la prise en charge par l'assureur du remboursement des échéances dues au prêteur.
2. Les difficultés de qualification de propre ou de commun ne peuvent naître que lorsque est en jeu un bien ou une créance des époux, non un bien ou une créance d'un tiers. Cette règle découle de la nature même de la communauté légale qui constitue un mode d'organisation des rapports pécuniaires entre époux et ne saurait concerner les éléments du patrimoine de tiers. L'indemnité ici versée par l'assureur au prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par les époux, est étrangère à la communauté ou au patrimoine propre des époux puisqu'elle ne transite pas par eux. La question de son caractère propre ou commun ne peut donc qu'être hors de propos en l'espèce et la Cour de cassation le rappelle à fort juste titre pour censurer les juges du fond.
3. Cette solution, qui confine au truisme, aurait pu facilement se passer de l'argument supplémentaire avancé par la Cour de cassation qui nous semble ainsi vouloir se prononcer par obiter dictum sur la nature juridique de l'indemnité d'assurance invalidité lorsqu'elle est versée, non à un tiers comme dans l'affaire qui lui était soumise, mais à un épouxNote de bas de page(1). Il est vrai que l'hypothèse sera sans doute plus rare en pratique, le prêteur préférant se faire désigner directement comme bénéficiaire plutôt que de voir les indemnités transiter par le patrimoine de l'assuré, mais elle n'est pas inconcevable. En outre, la solution suggérée par la Cour de cassation pourrait avoir vocation à s'appliquer, en dehors de l'hypothèse précise de l'espèce où l'assurance invalidité est adossée à un prêt, à toutes les indemnités versées à un époux au titre de ce type d'assurance.
Dans l'arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation ajoute que la nature propre de l'indemnité est également exclue du fait que, « versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt, [elle] a pour cause non la réparation d'un dommage corporel mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur ». Toute indemnité versée à un époux qui aurait pour cause non la réparation d'un dommage corporel mais une perte de revenus serait donc commune.
La formule se réfère au critère dégagé par les tribunaux pour qualifier les sommes versées au titre de l'indemnisation des accidents du travail : elles sont propres si le caractère indemnitaire l'emporte, communes si elles apparaissent plutôt comme un substitut à la perte de revenus, la jurisprudence ayant privilégié cette seconde analyseNote de bas de page(2). D'une manière plus générale, la Cour de cassation applique ce critère aux indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail, penchant très nettement en faveur du caractère commun, qu'il s'agisse d'une indemnité de licenciementNote de bas de page(3), d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travailNote de bas de page(4) ou d'une indemnité de départ en retraiteNote de bas de page(5), solution qui devrait également prévaloir pour une indemnité de non-concurrenceNote de bas de page(6). La Cour de cassation adopte donc une conception extensive de la notion de substitut de revenus qui lui permet d'étendre la qualification de bien commun, fidèle en cela à l'esprit communautaire du régime et à la formule particulièrement accueillante de l'article 1401 du code civil. Comme l'observe en ce sens le Doyen Cornu, « la vocation résiduelle de la communauté à absorber tout ce qui n'est pas exclusivement attaché à la personne suffit à fonder toutes ces non-exclusions »Note de bas de page(7).
Toutefois, s'agissant d'une indemnité due par un assureur suite à un contrat d'assurance de personne souscrit par la victime, la jurisprudence retient traditionnellement la qualification de propre, s'alignant sur la solution qu'elle a dégagée pour les dommages-intérêts accordés en réparation d'un dommage corporel ou moral, par application de l'article 1404 du code civilNote de bas de page(8). La jurisprudence a ainsi considéré que l'indemnité d'assurance versée en exécution d'un contrat d'assurance mixte comprenant une garantie en cas d'invalidité de l'un des époux souscripteur constitue un bien propre de l'époux victime du dommageNote de bas de page(9), sauf récompense si les primes payées par la communauté étaient exagérées. Cette solution semble généralement approuvée par la doctrineNote de bas de page(10).
4. Le critère évoqué par l'arrêt de la première Chambre civile du 14 décembre 2004 devrait en toute vraisemblance entraîner un changement dans la qualification de ce type d'indemnité d'assurance, comme l'avaient déjà suggéré quelques décisions des juges du fondNote de bas de page(11). En effet, l'assurance invalidité, si elle a son origine dans le dommage subi par l'assuré, si elle est due en raison du risque assuré qui est l'invalidité, n'a pas pour cause la réparation du dommage corporel qui intervient par application des règles d'un autre mécanisme juridique, qu'il s'agisse de la responsabilité civile ou du mécanisme spécial d'indemnisation des accidents du travail. Le versement d'une indemnité a pour cause le paiement des primes par la communauté et l'assurance invalidité a pour fonction de réparer la perte de revenus subie par l'époux qui ne peut ainsi exercer son activité, et plus largement donc par la communauté qui bénéficie des revenus de cette activité, comme en témoigne la périodicité de l'indemnité, périodicité qui constitue l'essence de la notion de revenusNote de bas de page(12). Cette fonction de substitut de revenus transparaît encore plus clairement en l'espèce dans le lien entre contrat d'assurance et contrat de prêt et plus précisément dans l'adéquation entre l'indemnité versée sous forme de rente et les échéances du prêt, elles-mêmes calculées en fonction des revenus du souscripteur qui sont d'une même périodicité et d'un même montant.
5. La solution suggérée par la première Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2004 traduit une nouvelle extension du « tout commun » qui s'inscrit dans les évolutions déjà amorcées par les décisions précédemment citées. En cela elle peut être approuvée, amorçant un regroupement sous la bannière commune de toutes les indemnités ayant une nature voisine. Certes cette solution diffère de celle retenue à propos de la nature juridique de la pension d'invalidité qu'une jurisprudence constante et fournie considère comme propreNote de bas de page(13), mais ce caractère propre est expressément reconnu aux « créances et pensions incessibles » par l'article 1404 du code civil, et de ce fait ne devrait pas être menacé par la solution suggérée par la Cour de cassation. La solution de la Cour de cassation présente enfin l'avantage d'être plus respectueuse de la lettre de l'article 1404 du code civil qui ne vise précisément que « les actions en réparation d'un dommage corporel », texte dérogatoire au principe général de chute des acquêts en communauté qui devrait donc être interprété strictement.
L'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2004 apporte ainsi une modeste mais fondée contribution à la délimitation entre la communauté et les patrimoines propres des époux.
La frontière entre biens communs et biens propres a priori clairement tracée par le code civil engendre pourtant un contentieux régulier, comme en témoigne récemment l'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2004. Deux époux mariés sous le régime de communauté légale concluent durant le mariage un prêt immobilier, le mari, tout comme son épouse d'ailleurs, ayant en outre souscrit une assurance invalidité garantissant le paiement des échéances de ce prêt. Le risque se réalisant du fait de l'insolvabilité du mari, l'assureur règle les échéances du prêt au prêteur bénéficiaire. Les deux époux divorçant, un litige naît sur la qualification des indemnités ainsi versées. Considérant que ces indemnités présentaient un caractère exclusivement personnel, la Cour d'appel d'Amiens les avait qualifiées de bien propre du mari dans un arrêt du 12 mars 2002, décision que censure la Cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2004.
Il faut observer de manière préliminaire que l'indemnité versée dans le cadre d'une assurance de chose n'est pas concernée par cette décision, sa nature propre ou commune découlant, par le mécanisme de la subrogation réelle, de la nature propre ou commune du bien assuré objet du sinistre. Etait ici en cause une assurance de personne, l'assurance invalidité, destinée à indemniser l'assuré suite à une invalidité dûment constatée. Cette assurance était en l'espèce adossée à un prêt de telle manière que l'invalidité d'un des époux entraînait la prise en charge par l'assureur du remboursement des échéances dues au prêteur.
2. Les difficultés de qualification de propre ou de commun ne peuvent naître que lorsque est en jeu un bien ou une créance des époux, non un bien ou une créance d'un tiers. Cette règle découle de la nature même de la communauté légale qui constitue un mode d'organisation des rapports pécuniaires entre époux et ne saurait concerner les éléments du patrimoine de tiers. L'indemnité ici versée par l'assureur au prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par les époux, est étrangère à la communauté ou au patrimoine propre des époux puisqu'elle ne transite pas par eux. La question de son caractère propre ou commun ne peut donc qu'être hors de propos en l'espèce et la Cour de cassation le rappelle à fort juste titre pour censurer les juges du fond.
3. Cette solution, qui confine au truisme, aurait pu facilement se passer de l'argument supplémentaire avancé par la Cour de cassation qui nous semble ainsi vouloir se prononcer par obiter dictum sur la nature juridique de l'indemnité d'assurance invalidité lorsqu'elle est versée, non à un tiers comme dans l'affaire qui lui était soumise, mais à un épouxNote de bas de page(1). Il est vrai que l'hypothèse sera sans doute plus rare en pratique, le prêteur préférant se faire désigner directement comme bénéficiaire plutôt que de voir les indemnités transiter par le patrimoine de l'assuré, mais elle n'est pas inconcevable. En outre, la solution suggérée par la Cour de cassation pourrait avoir vocation à s'appliquer, en dehors de l'hypothèse précise de l'espèce où l'assurance invalidité est adossée à un prêt, à toutes les indemnités versées à un époux au titre de ce type d'assurance.
Dans l'arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation ajoute que la nature propre de l'indemnité est également exclue du fait que, « versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt, [elle] a pour cause non la réparation d'un dommage corporel mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur ». Toute indemnité versée à un époux qui aurait pour cause non la réparation d'un dommage corporel mais une perte de revenus serait donc commune.
La formule se réfère au critère dégagé par les tribunaux pour qualifier les sommes versées au titre de l'indemnisation des accidents du travail : elles sont propres si le caractère indemnitaire l'emporte, communes si elles apparaissent plutôt comme un substitut à la perte de revenus, la jurisprudence ayant privilégié cette seconde analyseNote de bas de page(2). D'une manière plus générale, la Cour de cassation applique ce critère aux indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail, penchant très nettement en faveur du caractère commun, qu'il s'agisse d'une indemnité de licenciementNote de bas de page(3), d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travailNote de bas de page(4) ou d'une indemnité de départ en retraiteNote de bas de page(5), solution qui devrait également prévaloir pour une indemnité de non-concurrenceNote de bas de page(6). La Cour de cassation adopte donc une conception extensive de la notion de substitut de revenus qui lui permet d'étendre la qualification de bien commun, fidèle en cela à l'esprit communautaire du régime et à la formule particulièrement accueillante de l'article 1401 du code civil. Comme l'observe en ce sens le Doyen Cornu, « la vocation résiduelle de la communauté à absorber tout ce qui n'est pas exclusivement attaché à la personne suffit à fonder toutes ces non-exclusions »Note de bas de page(7).
Toutefois, s'agissant d'une indemnité due par un assureur suite à un contrat d'assurance de personne souscrit par la victime, la jurisprudence retient traditionnellement la qualification de propre, s'alignant sur la solution qu'elle a dégagée pour les dommages-intérêts accordés en réparation d'un dommage corporel ou moral, par application de l'article 1404 du code civilNote de bas de page(8). La jurisprudence a ainsi considéré que l'indemnité d'assurance versée en exécution d'un contrat d'assurance mixte comprenant une garantie en cas d'invalidité de l'un des époux souscripteur constitue un bien propre de l'époux victime du dommageNote de bas de page(9), sauf récompense si les primes payées par la communauté étaient exagérées. Cette solution semble généralement approuvée par la doctrineNote de bas de page(10).
4. Le critère évoqué par l'arrêt de la première Chambre civile du 14 décembre 2004 devrait en toute vraisemblance entraîner un changement dans la qualification de ce type d'indemnité d'assurance, comme l'avaient déjà suggéré quelques décisions des juges du fondNote de bas de page(11). En effet, l'assurance invalidité, si elle a son origine dans le dommage subi par l'assuré, si elle est due en raison du risque assuré qui est l'invalidité, n'a pas pour cause la réparation du dommage corporel qui intervient par application des règles d'un autre mécanisme juridique, qu'il s'agisse de la responsabilité civile ou du mécanisme spécial d'indemnisation des accidents du travail. Le versement d'une indemnité a pour cause le paiement des primes par la communauté et l'assurance invalidité a pour fonction de réparer la perte de revenus subie par l'époux qui ne peut ainsi exercer son activité, et plus largement donc par la communauté qui bénéficie des revenus de cette activité, comme en témoigne la périodicité de l'indemnité, périodicité qui constitue l'essence de la notion de revenusNote de bas de page(12). Cette fonction de substitut de revenus transparaît encore plus clairement en l'espèce dans le lien entre contrat d'assurance et contrat de prêt et plus précisément dans l'adéquation entre l'indemnité versée sous forme de rente et les échéances du prêt, elles-mêmes calculées en fonction des revenus du souscripteur qui sont d'une même périodicité et d'un même montant.
5. La solution suggérée par la première Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2004 traduit une nouvelle extension du « tout commun » qui s'inscrit dans les évolutions déjà amorcées par les décisions précédemment citées. En cela elle peut être approuvée, amorçant un regroupement sous la bannière commune de toutes les indemnités ayant une nature voisine. Certes cette solution diffère de celle retenue à propos de la nature juridique de la pension d'invalidité qu'une jurisprudence constante et fournie considère comme propreNote de bas de page(13), mais ce caractère propre est expressément reconnu aux « créances et pensions incessibles » par l'article 1404 du code civil, et de ce fait ne devrait pas être menacé par la solution suggérée par la Cour de cassation. La solution de la Cour de cassation présente enfin l'avantage d'être plus respectueuse de la lettre de l'article 1404 du code civil qui ne vise précisément que « les actions en réparation d'un dommage corporel », texte dérogatoire au principe général de chute des acquêts en communauté qui devrait donc être interprété strictement.
L'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2004 apporte ainsi une modeste mais fondée contribution à la délimitation entre la communauté et les patrimoines propres des époux.
Bien cordialement.
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Je reviens vers vous suite à votre réponse, car je suis un peu perdue dans ces réponses contradictoires :
Le second notaire (pas de récompense à cté) m’a dit textuellement pour justifier sa réponse, un passage du commentaire que vous m’avez envoyé (2) « l’indemnité versée par l’assurance au bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit par les époux est étrangère à la cté ou au patrimoine propre des époux puisqu’elle ne transite pas par eux. »
Je suis perplexe, cette indemnité doit donc être assimilée à une perte de revenus pour la communauté ? Comment cela peut-il se faire puisque la communauté est dissoute par le décès ? Dans le cadre d’une invalidité je suis d’accord pour dire qu’il y a perte de salaire, mais dans le cas précis je suis toujours interrogative. D’ailleurs je n’ai trouvé aucun jugement qui traite du décès, celui-ci n’est évoqué à aucun moment il s’agit toujours d’invalidité. Que cette indemnité ne soit pas un propre d’accord mais cela en fait-il un bien commun puisque versé à un tiers, pourquoi ne serait-elle pas un bien de succession, comme les arrérages de pension versés après décès ?
La communauté ne s’est pas appauvri au sens de l’article 1469 al3 qui dit « payés de deniers communs au cours du régime » après décès il n’y a plus de régime communautaire.
Recevez mes salutations.
Le second notaire (pas de récompense à cté) m’a dit textuellement pour justifier sa réponse, un passage du commentaire que vous m’avez envoyé (2) « l’indemnité versée par l’assurance au bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit par les époux est étrangère à la cté ou au patrimoine propre des époux puisqu’elle ne transite pas par eux. »
Je suis perplexe, cette indemnité doit donc être assimilée à une perte de revenus pour la communauté ? Comment cela peut-il se faire puisque la communauté est dissoute par le décès ? Dans le cadre d’une invalidité je suis d’accord pour dire qu’il y a perte de salaire, mais dans le cas précis je suis toujours interrogative. D’ailleurs je n’ai trouvé aucun jugement qui traite du décès, celui-ci n’est évoqué à aucun moment il s’agit toujours d’invalidité. Que cette indemnité ne soit pas un propre d’accord mais cela en fait-il un bien commun puisque versé à un tiers, pourquoi ne serait-elle pas un bien de succession, comme les arrérages de pension versés après décès ?
La communauté ne s’est pas appauvri au sens de l’article 1469 al3 qui dit « payés de deniers communs au cours du régime » après décès il n’y a plus de régime communautaire.
Recevez mes salutations.
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Bonsoir monsieur,
C'est juste mais cela vaut que si le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est un tiers au couple. Il faut replacer la phrase dans ce contexte.
Selon moi, votre notaire (le deuxième s'est trompé). L'indemnité n'est ici pas versée à un tiers mais bien au conjoint de la personne décédée.
Non, pas exactement. Simplement,l'indemnité est destinée à compenser une perte des revenus du ménage. Autrement dit, cette assurance est destinée à rembourser un crédit que vous n'auriez pas pu rembourser tout seul, faute d'avoir un deuxième salaire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le terme "perte de revenu".
Dissoute mais pas encore liquidée, c'est là tout le problème. L'indemnité versée par l'assurance est un bien commun subrogée aux primes qui ont été versées par la communauté. Ce qui compte, c'est le fait générateur de l'indemnité que vous avez reçue. Ce fait générateur se trouvant être la date de souscription du contrat.
L'indemnité n'est pas versée à un tiers au couple, d'où le problème.
C'est la subrogation qui joue. Le décès ne joue donc pas (à mon sens).
Bien cordialement.
Citation :
« l’indemnité versée par l’assurance au bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit par les époux est étrangère à la cté ou au patrimoine propre des époux puisqu’elle ne transite pas par eux. »
« l’indemnité versée par l’assurance au bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit par les époux est étrangère à la cté ou au patrimoine propre des époux puisqu’elle ne transite pas par eux. »
C'est juste mais cela vaut que si le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est un tiers au couple. Il faut replacer la phrase dans ce contexte.
Selon moi, votre notaire (le deuxième s'est trompé). L'indemnité n'est ici pas versée à un tiers mais bien au conjoint de la personne décédée.
Citation :
Je suis perplexe, cette indemnité doit donc être assimilée à une perte de revenus pour la communauté ?
Je suis perplexe, cette indemnité doit donc être assimilée à une perte de revenus pour la communauté ?
Non, pas exactement. Simplement,l'indemnité est destinée à compenser une perte des revenus du ménage. Autrement dit, cette assurance est destinée à rembourser un crédit que vous n'auriez pas pu rembourser tout seul, faute d'avoir un deuxième salaire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le terme "perte de revenu".
Citation :
Comment cela peut-il se faire puisque la communauté est dissoute par le décès ?
Comment cela peut-il se faire puisque la communauté est dissoute par le décès ?
Dissoute mais pas encore liquidée, c'est là tout le problème. L'indemnité versée par l'assurance est un bien commun subrogée aux primes qui ont été versées par la communauté. Ce qui compte, c'est le fait générateur de l'indemnité que vous avez reçue. Ce fait générateur se trouvant être la date de souscription du contrat.
Citation :
Que cette indemnité ne soit pas un propre d’accord mais cela en fait-il un bien commun puisque versé à un tiers
Que cette indemnité ne soit pas un propre d’accord mais cela en fait-il un bien commun puisque versé à un tiers
L'indemnité n'est pas versée à un tiers au couple, d'où le problème.
Citation :
La communauté ne s’est pas appauvri au sens de l’article 1469 al3 qui dit « payés de deniers communs au cours du régime » après décès il n’y a plus de régime communautaire.
La communauté ne s’est pas appauvri au sens de l’article 1469 al3 qui dit « payés de deniers communs au cours du régime » après décès il n’y a plus de régime communautaire.
C'est la subrogation qui joue. Le décès ne joue donc pas (à mon sens).
Bien cordialement.
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Bonsoir, Madame Monsieur
Citation :
« L’indemnité versée par l’assurance au bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit par les époux est étrangère à la cté ou au patrimoine propre des époux puisqu’elle ne transite pas par eux. »
Votre réponse
C'est juste mais cela vaut que si le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est un tiers au couple. Il faut replacer la phrase dans ce contexte.
L'indemnité n'est pas versée à un tiers au couple, d'où le problème
Selon moi, votre notaire (le deuxième s'est trompé)
L'indemnité n'est ici pas versée à un tiers mais bien au conjoint de la personne décédée
Pour moi, c’est bien à un tiers,la banque, qui a perçu le capital restant du et non une indemnité
Rien n’a transité par la communauté.
Le tiers subrogataire, la banque, devient le créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant , art 1249 il s’agit donc bien d’un tiers au couple
votre reponse
Simplement, l’indemnité est destinée à compenser une perte des revenus du ménage. Autrement dit, cette assurance est destinée à rembourser un crédit que vous n'auriez pas pu rembourser tout seul, faute d'avoir un deuxième salaire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le terme "perte de revenu".
pour moi
Cet argument ne tient pas, le de cujus était sans revenu ni salaire, seul le survivant était solvable.
Dissoute mais pas encore liquidée, c'est là tout le problème....
Pour moi : la communauté est dissoute au décès, n’est ce pas cette datte qui est retenue pour calculer la quotité disponible, la réserve héréditaire, l’avantage matrimonial etc. A la date du décès nous entrons dans la succession qui se terminera au jour du partage, la date de jouissance divise intervenant avant la partage. Les arrérages de pensions font d’ailleurs parti de la succession et non de la communauté pourquoi pas le capital remboursé ?
vous dites
L'indemnité versée par l'assurance est un bien commun subrogée aux primes qui ont été versées par la communauté. Ce qui compte, c'est le fait générateur de l'indemnité que vous avez reçue. Ce fait générateur se trouvant être la date de souscription du contrat. Dites vous
Comment : votre réponse, si les mots ont un sens, peut-elle être crédible, ce n’est pas la date de souscription du contrat qui est le fait générateur du paiement mais le décès de l’assuré .Le contrat défini les modalités de l’assurance., pas sa mise en « route »
L'indemnité versée par l'assurance est un bien commun subrogée aux primes qui ont été versées par la communauté ????
Là je ne comprends plus. Les primes versés par la communauté ont été versées avant décès, l’assurance n’a rien pris en charge ce qui est normal, donc pas de subrogation. Après le décès la communauté n’a plus rien versé, le capital pris en charge par l’assurance a été directement versé aux organismes prêteurs.Là il y a subrogation,mais pas dans la même configuration que pour "certaine " invalidité et c'est là tout le problème.
cf cour d'appel de Toulouse arret 256 du 17 mars 1999
citation C'est la subrogation qui joue. Le décès ne joue donc pas (à mon sens).
Pour moi C'est imcompréhenible car pas de décès pas de subrogation
La subrogation joue du fait du décès, celui-ci a donc un rôle déterminant !
Je regrette que votre thèse ne s’appuie sur aucune jurisprudence et que par ailleurs vous faite abstraction de l’article 1469.
Sans rancune
bonsoir.
Citation :
« L’indemnité versée par l’assurance au bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit par les époux est étrangère à la cté ou au patrimoine propre des époux puisqu’elle ne transite pas par eux. »
Votre réponse
C'est juste mais cela vaut que si le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est un tiers au couple. Il faut replacer la phrase dans ce contexte.
L'indemnité n'est pas versée à un tiers au couple, d'où le problème
Selon moi, votre notaire (le deuxième s'est trompé)
L'indemnité n'est ici pas versée à un tiers mais bien au conjoint de la personne décédée
Pour moi, c’est bien à un tiers,la banque, qui a perçu le capital restant du et non une indemnité
Rien n’a transité par la communauté.
Le tiers subrogataire, la banque, devient le créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant , art 1249 il s’agit donc bien d’un tiers au couple
votre reponse
Simplement, l’indemnité est destinée à compenser une perte des revenus du ménage. Autrement dit, cette assurance est destinée à rembourser un crédit que vous n'auriez pas pu rembourser tout seul, faute d'avoir un deuxième salaire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le terme "perte de revenu".
pour moi
Cet argument ne tient pas, le de cujus était sans revenu ni salaire, seul le survivant était solvable.
Dissoute mais pas encore liquidée, c'est là tout le problème....
Pour moi : la communauté est dissoute au décès, n’est ce pas cette datte qui est retenue pour calculer la quotité disponible, la réserve héréditaire, l’avantage matrimonial etc. A la date du décès nous entrons dans la succession qui se terminera au jour du partage, la date de jouissance divise intervenant avant la partage. Les arrérages de pensions font d’ailleurs parti de la succession et non de la communauté pourquoi pas le capital remboursé ?
vous dites
L'indemnité versée par l'assurance est un bien commun subrogée aux primes qui ont été versées par la communauté. Ce qui compte, c'est le fait générateur de l'indemnité que vous avez reçue. Ce fait générateur se trouvant être la date de souscription du contrat. Dites vous
Comment : votre réponse, si les mots ont un sens, peut-elle être crédible, ce n’est pas la date de souscription du contrat qui est le fait générateur du paiement mais le décès de l’assuré .Le contrat défini les modalités de l’assurance., pas sa mise en « route »
L'indemnité versée par l'assurance est un bien commun subrogée aux primes qui ont été versées par la communauté ????
Là je ne comprends plus. Les primes versés par la communauté ont été versées avant décès, l’assurance n’a rien pris en charge ce qui est normal, donc pas de subrogation. Après le décès la communauté n’a plus rien versé, le capital pris en charge par l’assurance a été directement versé aux organismes prêteurs.Là il y a subrogation,mais pas dans la même configuration que pour "certaine " invalidité et c'est là tout le problème.
cf cour d'appel de Toulouse arret 256 du 17 mars 1999
citation C'est la subrogation qui joue. Le décès ne joue donc pas (à mon sens).
Pour moi C'est imcompréhenible car pas de décès pas de subrogation
La subrogation joue du fait du décès, celui-ci a donc un rôle déterminant !
Je regrette que votre thèse ne s’appuie sur aucune jurisprudence et que par ailleurs vous faite abstraction de l’article 1469.
Sans rancune
bonsoir.
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Bonjour madame,
Vous m'avez demandé mon avis dans une affaire où deux notaires sont en désaccords. N'allez pas croire que je vais vous dire le droit tel que le dira votre juge (ce n'est point ma fonction), vous m'interpelez pour que je vous donne mon avis, ce qui est différent.
Vos arguments sont pertinents mais je ne les partage point.
Relisez l'arrêt de du 14 décembre 2004, et vous prendez connaissance que la Cour de cassation rejette le caractère propre de l'indemnité alors même que l'indemnité avait été versée directement par l'assurance à l'organisme prêteur.
Je vous copie l'abstract de la décision:
"Il résulte de l'article 1404 du Code civil que constituent des propres par leur nature les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel ou moral.
Viole ce texte la cour d'appel qui qualifie de biens propres à un époux des remboursements d'emprunt effectués par une caisse de prévoyance, auprès de laquelle celui-ci, marié sous le régime de communauté légale, ainsi que son épouse, ont contracté une assurance invalidité garantissant le paiement des échéances d'un prêt immobilier, alors que le bénéficiaire du contrat d'assurance est la société de crédit et que l'indemnité versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt a pour cause, non la réparation d'un dommage corporel, mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur. "
Le commentaire d'arrêt laisse trainer une incertitude qui est celui du caractère transitoire de l'indemnité.
Les primes ont été payées par la communauté, elles ont vocation à compenser une perte de revenu de la communauté, donc le bien est commun.
Il ne s'agit pas ici d'un mécanisme de subrogation mais d'une stipulation pour autrui.
Afin d'améliorer votre compréhension, admettons que la subrogation joue.
Mais qui est le subrogé? Selon moi, c'est la communauté puisque c'est elle qui a payée les primes et que c'est elle qui a souscrit le contrat d'assurance.
Ainsi, vous faites erreur. Le tiers subrogataire n'est pas la banque mais l'assureur puisque c'est l'assureur qui a remboursé le prêt et qui de ce fait, deviendrait le créancier du "subrogé" en vertu des droits du banquier.
Selon votre conception donc, l'assureur pourrait vous demander de rembourser l'intégralité de l'indemnité qu'elle a versée à la banque en vertu de la subrogation.
vous admettez donc que ce n'est pas le but d'une assurance?!
Ce n'est pas mon argument mais celui qui justifie le maintien de cette jurisprudence. Je n'ai pas vocation à "dire" le droit, moi.
Juridiquement, vous faites erreur. Je comprends bien votre reflexion mais c'est bien la date de souscription qui compte.
Admettons que j'achete un ticket de loto (avec l'argent commun). Ma femme décède. Si je gagne alors, l'argent sera commun sur le fondement de la subrogation. Le gain est une subrogation du ticket qui a été acheté pendant le mariage.
Idem pour un contrat de vente.
Parce que si vous n'aviez pas souscrit d'assurance, l'assurance aurait quand même remboursée le prêt?
En réalité, la souscription est le fait générateur de l'intemnité d'assurance dont le décès de l'assuré n'est qu'une condition suspensive.
Même réponse que Supra.
Non, elle s'appuie juste que sur une jurisprudence que vous m'avez citée en demande.
Relisons l'article 1469 du Code civil:
"Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur."
Si vous lisez bien l'article, il s'en suit que l'argent dépensée par la commuanauté pour acquérir, conservé ou améliorer un bien propre donne droit à récompense.. Qui dit récompense, dit communauté, vous n'êtes pas d'accord?
Que l'on soit bien d'accord, mon objectif est de vous aider dans votre démarche. Mon travail est de vous aider à faire valloir des arguments qui, s'ils sont opposés au votre, vont vous permettre d'avancer.
Les notaires sont souvents médiocres (d'où la contradiction entre eux). Les avocats le sont moins mais vendraient parfois père et mère pour plaider un bon dossier.
Et moi?
Et bien, je vous offre un espace de discussion, dans le respect de l'autre. Une sorte de "jugement avant jugement", sans arbitre, où tous les arguments sont recevables.
Je ne me permets pas ce genre de pratique avec le premier "quidam" mais vous êtes une dame intelligente et qui comprends vite. Aussi, mon argumentation a réellement pour but de vous faire avancer. J'espère que vous le comprenez ainsi.
(mais pour autant, je reste sur ma position :)
Bien cordialement.
Vous m'avez demandé mon avis dans une affaire où deux notaires sont en désaccords. N'allez pas croire que je vais vous dire le droit tel que le dira votre juge (ce n'est point ma fonction), vous m'interpelez pour que je vous donne mon avis, ce qui est différent.
Vos arguments sont pertinents mais je ne les partage point.
Relisez l'arrêt de du 14 décembre 2004, et vous prendez connaissance que la Cour de cassation rejette le caractère propre de l'indemnité alors même que l'indemnité avait été versée directement par l'assurance à l'organisme prêteur.
Je vous copie l'abstract de la décision:
"Il résulte de l'article 1404 du Code civil que constituent des propres par leur nature les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel ou moral.
Viole ce texte la cour d'appel qui qualifie de biens propres à un époux des remboursements d'emprunt effectués par une caisse de prévoyance, auprès de laquelle celui-ci, marié sous le régime de communauté légale, ainsi que son épouse, ont contracté une assurance invalidité garantissant le paiement des échéances d'un prêt immobilier, alors que le bénéficiaire du contrat d'assurance est la société de crédit et que l'indemnité versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt a pour cause, non la réparation d'un dommage corporel, mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur. "
Le commentaire d'arrêt laisse trainer une incertitude qui est celui du caractère transitoire de l'indemnité.
Les primes ont été payées par la communauté, elles ont vocation à compenser une perte de revenu de la communauté, donc le bien est commun.
Citation :
Le tiers subrogataire, la banque, devient le créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant , art 1249 il s’agit donc bien d’un tiers au couple
Le tiers subrogataire, la banque, devient le créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant , art 1249 il s’agit donc bien d’un tiers au couple
Il ne s'agit pas ici d'un mécanisme de subrogation mais d'une stipulation pour autrui.
Afin d'améliorer votre compréhension, admettons que la subrogation joue.
Mais qui est le subrogé? Selon moi, c'est la communauté puisque c'est elle qui a payée les primes et que c'est elle qui a souscrit le contrat d'assurance.
Ainsi, vous faites erreur. Le tiers subrogataire n'est pas la banque mais l'assureur puisque c'est l'assureur qui a remboursé le prêt et qui de ce fait, deviendrait le créancier du "subrogé" en vertu des droits du banquier.
Selon votre conception donc, l'assureur pourrait vous demander de rembourser l'intégralité de l'indemnité qu'elle a versée à la banque en vertu de la subrogation.
vous admettez donc que ce n'est pas le but d'une assurance?!
Citation :
Cet argument ne tient pas, le de cujus était sans revenu ni salaire, seul le survivant était solvable.
Cet argument ne tient pas, le de cujus était sans revenu ni salaire, seul le survivant était solvable.
Ce n'est pas mon argument mais celui qui justifie le maintien de cette jurisprudence. Je n'ai pas vocation à "dire" le droit, moi.
Citation :
votre réponse, si les mots ont un sens, peut-elle être crédible, ce n’est pas la date de souscription du contrat qui est le fait générateur du paiement mais le décès de l’assuré .Le contrat défini les modalités de l’assurance., pas sa mise en « route »
votre réponse, si les mots ont un sens, peut-elle être crédible, ce n’est pas la date de souscription du contrat qui est le fait générateur du paiement mais le décès de l’assuré .Le contrat défini les modalités de l’assurance., pas sa mise en « route »
Juridiquement, vous faites erreur. Je comprends bien votre reflexion mais c'est bien la date de souscription qui compte.
Admettons que j'achete un ticket de loto (avec l'argent commun). Ma femme décède. Si je gagne alors, l'argent sera commun sur le fondement de la subrogation. Le gain est une subrogation du ticket qui a été acheté pendant le mariage.
Idem pour un contrat de vente.
Citation :
Après le décès la communauté n’a plus rien versé, le capital pris en charge par l’assurance a été directement versé aux organismes prêteurs.
Après le décès la communauté n’a plus rien versé, le capital pris en charge par l’assurance a été directement versé aux organismes prêteurs.
Parce que si vous n'aviez pas souscrit d'assurance, l'assurance aurait quand même remboursée le prêt?
En réalité, la souscription est le fait générateur de l'intemnité d'assurance dont le décès de l'assuré n'est qu'une condition suspensive.
Citation :
La subrogation joue du fait du décès, celui-ci a donc un rôle déterminant !
La subrogation joue du fait du décès, celui-ci a donc un rôle déterminant !
Même réponse que Supra.
Citation :
Je regrette que votre thèse ne s’appuie sur aucune jurisprudence et que par ailleurs vous faite abstraction de l’article 1469.
Je regrette que votre thèse ne s’appuie sur aucune jurisprudence et que par ailleurs vous faite abstraction de l’article 1469.
Non, elle s'appuie juste que sur une jurisprudence que vous m'avez citée en demande.
Relisons l'article 1469 du Code civil:
"Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur."
Si vous lisez bien l'article, il s'en suit que l'argent dépensée par la commuanauté pour acquérir, conservé ou améliorer un bien propre donne droit à récompense.. Qui dit récompense, dit communauté, vous n'êtes pas d'accord?
Que l'on soit bien d'accord, mon objectif est de vous aider dans votre démarche. Mon travail est de vous aider à faire valloir des arguments qui, s'ils sont opposés au votre, vont vous permettre d'avancer.
Les notaires sont souvents médiocres (d'où la contradiction entre eux). Les avocats le sont moins mais vendraient parfois père et mère pour plaider un bon dossier.
Et moi?
Et bien, je vous offre un espace de discussion, dans le respect de l'autre. Une sorte de "jugement avant jugement", sans arbitre, où tous les arguments sont recevables.
Je ne me permets pas ce genre de pratique avec le premier "quidam" mais vous êtes une dame intelligente et qui comprends vite. Aussi, mon argumentation a réellement pour but de vous faire avancer. J'espère que vous le comprenez ainsi.
(mais pour autant, je reste sur ma position :)
Bien cordialement.
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Bonjour,
Je croyais que subroger voulait dire remplacer, que la banque le subrogataire devenait alors le créancier du subrogé, l’assurance, au lieu et place du subrogeant, la communauté créancière initiale, c’est pourquoi je dis que le capital restant du n’a pas transité par la communauté. Je comprends donc que l’assurance est le subrogé de la cté.
Mais la lecture juridique est tellement « vicieuse » que je peux me tromper, ce domaine n’étant pas ma branche !.
J’essaie d’argumenter à tord peut-être que seul les remboursements effectués par la cté donnent lieu à récompense (le capital s’entend)
Hier j’ai rencontré un nouveau notaire (chambre des notaires ) qui a abondé dans mon sens disant : « la récompense doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite cté ont contribué au financement, dans le cas ou le financement est partiel ,la récompense le sera également. Par fond empruntés à la cté j’entends les remboursements effectués par elle.
OUI je voudrais avancé dans cette liquidation qui dure depuis plus de 15 ans.
Pour tout vous dire je ne suis pas concernée , j’essaie d’aider les enfants du premier lit du de cujus et qui ne sont pas les miens.
Ceux-ci ont découvert au décès de leur père que celui-ci après son divorce avait acheté un terrain à sa concubine en vue de sa construction, s’était porté co emprunter avec cette dame insolvable sans pour autant devenir propriétaire. Ils se sont ensuite mariés adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant. 8 ans plus tard Mme a demandé le divorce M a mis fin à ses jours…laissant deux enfants d’un premier mariage avec une première cté non réglée… un vrai poème !
Un jugement a ordonné la liquidation tout en confirmant que Mme avait opté pour un tiers en pleine propriété, nous en sommes donc à liquider la succession mais c’est ardu.
Il faut calculer la réserve, la quotité disponible et bien sur l’avantage matrimonial
C’est pourquoi nous cherchons à avoir un actif net de cté légale le plus faible possible c’est le but de ma démarche. Si le demi de cté légale est très consistant la réserve se verra diminuée d’autant Le suicide de M. enrichira Mme ! Quelque part il y a iniquité d’autant plus que selon le notaire les fruits des biens « propre » de Monsieur après décès restent acquis à la veuve dans leur totalité. Le tribunal a prononcé une indemnité d’occupation pour le fameux immeuble de Mme du fait de l’option en peine propriété, du moins je pense, le notaire me dit erreur de jugement. La cour de cass a cependant entériné. Comme vous pouvez le voir le problème n’est pas simple. Je vous dit cela pour vous éclairer sur l’ensemble de la situation qui me préoccupe Votre empressement à me répondre m’incite à vous énoncez les faits, pas pour vous convaincre ni vous solliciter.
Comme vous je dirais que les notaires sont parfois médiocres j’ajoute que certains sont de parfait voyous se retranchant derrière le « fameux mot transaction » pour se mettre à couvert. Pour faire un contrat de mariage adoptant cté universelle avec attribution intégrale au survivant, alors que la première cte n’est pas liquidée, qu’il y a des enfants d’un premier lit et ayant aussi fait les actes de vente et de prêts, je serais juge je les révoquerais .Je partage votre opinion sur les avocats( je ne sais si vous en êtes un) Malheureusement il plaident « tout » sans savoir bien souvent comment çà marche. Demandent au notaire comment se font les calculs et lorsque celui-ci se « plante » c’est tout le monde qui en subit les conséquences. Si les enfants n’avaient pas suivis un CRIDON que je ne nommerais pas, ils ne seraient pas allé en appel ni en cassation. Il y a matière à méditer et à écrire sur cette « foutue cté universelle » avec tous ses détours. Il vaudrait mieux dire : les enfants n’héritent pas de leur géniteur, que de dire les enfants d’un premier lit sont protégés en donnant tous les moyens pour qu’ils le soient au minimum et se trouvent devant des situations inextricables.
Je vous devais cette explication, excusez la longueur. Recevez mes salutations distinguées
Je croyais que subroger voulait dire remplacer, que la banque le subrogataire devenait alors le créancier du subrogé, l’assurance, au lieu et place du subrogeant, la communauté créancière initiale, c’est pourquoi je dis que le capital restant du n’a pas transité par la communauté. Je comprends donc que l’assurance est le subrogé de la cté.
Mais la lecture juridique est tellement « vicieuse » que je peux me tromper, ce domaine n’étant pas ma branche !.
J’essaie d’argumenter à tord peut-être que seul les remboursements effectués par la cté donnent lieu à récompense (le capital s’entend)
Hier j’ai rencontré un nouveau notaire (chambre des notaires ) qui a abondé dans mon sens disant : « la récompense doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite cté ont contribué au financement, dans le cas ou le financement est partiel ,la récompense le sera également. Par fond empruntés à la cté j’entends les remboursements effectués par elle.
OUI je voudrais avancé dans cette liquidation qui dure depuis plus de 15 ans.
Pour tout vous dire je ne suis pas concernée , j’essaie d’aider les enfants du premier lit du de cujus et qui ne sont pas les miens.
Ceux-ci ont découvert au décès de leur père que celui-ci après son divorce avait acheté un terrain à sa concubine en vue de sa construction, s’était porté co emprunter avec cette dame insolvable sans pour autant devenir propriétaire. Ils se sont ensuite mariés adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant. 8 ans plus tard Mme a demandé le divorce M a mis fin à ses jours…laissant deux enfants d’un premier mariage avec une première cté non réglée… un vrai poème !
Un jugement a ordonné la liquidation tout en confirmant que Mme avait opté pour un tiers en pleine propriété, nous en sommes donc à liquider la succession mais c’est ardu.
Il faut calculer la réserve, la quotité disponible et bien sur l’avantage matrimonial
C’est pourquoi nous cherchons à avoir un actif net de cté légale le plus faible possible c’est le but de ma démarche. Si le demi de cté légale est très consistant la réserve se verra diminuée d’autant Le suicide de M. enrichira Mme ! Quelque part il y a iniquité d’autant plus que selon le notaire les fruits des biens « propre » de Monsieur après décès restent acquis à la veuve dans leur totalité. Le tribunal a prononcé une indemnité d’occupation pour le fameux immeuble de Mme du fait de l’option en peine propriété, du moins je pense, le notaire me dit erreur de jugement. La cour de cass a cependant entériné. Comme vous pouvez le voir le problème n’est pas simple. Je vous dit cela pour vous éclairer sur l’ensemble de la situation qui me préoccupe Votre empressement à me répondre m’incite à vous énoncez les faits, pas pour vous convaincre ni vous solliciter.
Comme vous je dirais que les notaires sont parfois médiocres j’ajoute que certains sont de parfait voyous se retranchant derrière le « fameux mot transaction » pour se mettre à couvert. Pour faire un contrat de mariage adoptant cté universelle avec attribution intégrale au survivant, alors que la première cte n’est pas liquidée, qu’il y a des enfants d’un premier lit et ayant aussi fait les actes de vente et de prêts, je serais juge je les révoquerais .Je partage votre opinion sur les avocats( je ne sais si vous en êtes un) Malheureusement il plaident « tout » sans savoir bien souvent comment çà marche. Demandent au notaire comment se font les calculs et lorsque celui-ci se « plante » c’est tout le monde qui en subit les conséquences. Si les enfants n’avaient pas suivis un CRIDON que je ne nommerais pas, ils ne seraient pas allé en appel ni en cassation. Il y a matière à méditer et à écrire sur cette « foutue cté universelle » avec tous ses détours. Il vaudrait mieux dire : les enfants n’héritent pas de leur géniteur, que de dire les enfants d’un premier lit sont protégés en donnant tous les moyens pour qu’ils le soient au minimum et se trouvent devant des situations inextricables.
Je vous devais cette explication, excusez la longueur. Recevez mes salutations distinguées
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Bonjour,
Revenons en à la définition de la subrogation:
Donc, appliqué à votre cas (où la subrogation ne s'applique pas à mon sens): Le tiers suborgataire est l'assurance dans la mesure où elle a remboursé votre dette à l'égard du banquier (le subrogeant) en lieu et place du débiteur initial (le subrogé).
En droit, l'intérêt de la subrogation et qu'elle permet à une personne qui n'était pas le débiteur principal, mais qui a payé la dette du débiteur de se retourner contre ce dernier.
Le plus bel exemple de subrogation est celui de la caution. Lorsque la caution paye à la place du débiteur, elle peut se retourner contre ce dernier pour lui en demander le remboursement.
C'est un point de Droit délicat, je le reconnais d'où l'existence d'un désaccord. Je comprends que vous soyez perdue!
Après de nombreuses recherches, je dois vous avouer que je commence à mettre de l'eau dans mon vin. Je n'ai toujours pas changé d'avis mais j'avoue que la situation est plus délicate que ce que je croyais.
Les articles de Droit ne sont pas du tout limpides et je n'ai trouvé aucun document (c'est pas faute de recherche) relatant votre cas.
Si le notaire liquidateur abonde dans votre sens, tant mieux. Sinon, il conviendrait de saisir la justice de cette question.
Si aux problèmes humains se sont substitués des problèmes juridiques, je comprends la complication.
Madame a pris le 1/4 en pleine propriété et non le tiers non?
Madame paye une indemnité d'occupation pour habiter une maison qui lui est propre?/!?
Vous pouvez tout à fait chercher à me convaincre. Vous pouvez également tout me dire, je suis ici pour ça et votre problème est pour le moins interessant juridiquement parlant.
Durant mes études de droit, on m'a enseigné la garantie des vices cachés en nous expliquant que c'est une garantie fondamentale de protection de l'acquéreur. Cela permet de réparer les mauvaises surprises.
Un jour, de l'aveu même d'un notaire, j'ai appri que les notaires excluaient tout le temps la garantie des vices cachés pour se couvrir au cas où. Bien evidemment, le notaire se tait et l'acquéreur non juriste ne s'en apperçoit pas.
Résultat: Les acquéreurs qui constatent des malfaçons qui ont été maquillées ne peuvent rien faire et cela arrive tous les jours. Justice ou couverture du notaire?
J'enseigne le Droit civil et le Droit pénal à la Faculté de Droit de montpellier. Position neutre qui me permet au demeurant d'échapper à tout corporatisme!
Ne vous excusez surtout pas, c'était un plaisir pour moi.
Bien cordialement.
Citation :
Je croyais que subroger voulait dire remplacer, que la banque le subrogataire devenait alors le créancier du subrogé, l’assurance, au lieu et place du subrogeant, la communauté créancière initiale, c’est pourquoi je dis que le capital restant du n’a pas transité par la communauté.
Je croyais que subroger voulait dire remplacer, que la banque le subrogataire devenait alors le créancier du subrogé, l’assurance, au lieu et place du subrogeant, la communauté créancière initiale, c’est pourquoi je dis que le capital restant du n’a pas transité par la communauté.
Revenons en à la définition de la subrogation:
Citation :
Le tiers (subrogataire) devient créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant (créancier initial) et il peut exercer les actions que par ce moyen le titulaire lui transmet contre son propre débiteur.
Le tiers (subrogataire) devient créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant (créancier initial) et il peut exercer les actions que par ce moyen le titulaire lui transmet contre son propre débiteur.
Donc, appliqué à votre cas (où la subrogation ne s'applique pas à mon sens): Le tiers suborgataire est l'assurance dans la mesure où elle a remboursé votre dette à l'égard du banquier (le subrogeant) en lieu et place du débiteur initial (le subrogé).
En droit, l'intérêt de la subrogation et qu'elle permet à une personne qui n'était pas le débiteur principal, mais qui a payé la dette du débiteur de se retourner contre ce dernier.
Le plus bel exemple de subrogation est celui de la caution. Lorsque la caution paye à la place du débiteur, elle peut se retourner contre ce dernier pour lui en demander le remboursement.
Citation :
J’essaie d’argumenter à tord peut-être que seul les remboursements effectués par la cté donnent lieu à récompense (le capital s’entend)
J’essaie d’argumenter à tord peut-être que seul les remboursements effectués par la cté donnent lieu à récompense (le capital s’entend)
C'est un point de Droit délicat, je le reconnais d'où l'existence d'un désaccord. Je comprends que vous soyez perdue!
Citation :
la récompense doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite cté ont contribué au financement, dans le cas ou le financement est partiel ,la récompense le sera également. Par fond empruntés à la cté j’entends les remboursements effectués par elle.
la récompense doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite cté ont contribué au financement, dans le cas ou le financement est partiel ,la récompense le sera également. Par fond empruntés à la cté j’entends les remboursements effectués par elle.
Après de nombreuses recherches, je dois vous avouer que je commence à mettre de l'eau dans mon vin. Je n'ai toujours pas changé d'avis mais j'avoue que la situation est plus délicate que ce que je croyais.
Les articles de Droit ne sont pas du tout limpides et je n'ai trouvé aucun document (c'est pas faute de recherche) relatant votre cas.
Si le notaire liquidateur abonde dans votre sens, tant mieux. Sinon, il conviendrait de saisir la justice de cette question.
Citation :
OUI je voudrais avancé dans cette liquidation qui dure depuis plus de 15 ans.
Pour tout vous dire je ne suis pas concernée , j’essaie d’aider les enfants du premier lit du de cujus et qui ne sont pas les miens.
Ceux-ci ont découvert au décès de leur père que celui-ci après son divorce avait acheté un terrain à sa concubine en vue de sa construction, s’était porté co emprunter avec cette dame insolvable sans pour autant devenir propriétaire. Ils se sont ensuite mariés adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant. 8 ans plus tard Mme a demandé le divorce M a mis fin à ses jours…laissant deux enfants d’un premier mariage avec une première cté non réglée… un vrai poème !
Un jugement a ordonné la liquidation tout en confirmant que Mme avait opté pour un tiers en pleine propriété, nous en sommes donc à liquider la succession mais c’est ardu.
OUI je voudrais avancé dans cette liquidation qui dure depuis plus de 15 ans.
Pour tout vous dire je ne suis pas concernée , j’essaie d’aider les enfants du premier lit du de cujus et qui ne sont pas les miens.
Ceux-ci ont découvert au décès de leur père que celui-ci après son divorce avait acheté un terrain à sa concubine en vue de sa construction, s’était porté co emprunter avec cette dame insolvable sans pour autant devenir propriétaire. Ils se sont ensuite mariés adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant. 8 ans plus tard Mme a demandé le divorce M a mis fin à ses jours…laissant deux enfants d’un premier mariage avec une première cté non réglée… un vrai poème !
Un jugement a ordonné la liquidation tout en confirmant que Mme avait opté pour un tiers en pleine propriété, nous en sommes donc à liquider la succession mais c’est ardu.
Si aux problèmes humains se sont substitués des problèmes juridiques, je comprends la complication.
Madame a pris le 1/4 en pleine propriété et non le tiers non?
Citation :
Le tribunal a prononcé une indemnité d’occupation pour le fameux immeuble de Mme du fait de l’option en peine propriété, du moins je pense
Le tribunal a prononcé une indemnité d’occupation pour le fameux immeuble de Mme du fait de l’option en peine propriété, du moins je pense
Madame paye une indemnité d'occupation pour habiter une maison qui lui est propre?/!?
Citation :
Je vous dit cela pour vous éclairer sur l’ensemble de la situation qui me préoccupe Votre empressement à me répondre m’incite à vous énoncez les faits, pas pour vous convaincre ni vous solliciter.
Je vous dit cela pour vous éclairer sur l’ensemble de la situation qui me préoccupe Votre empressement à me répondre m’incite à vous énoncez les faits, pas pour vous convaincre ni vous solliciter.
Vous pouvez tout à fait chercher à me convaincre. Vous pouvez également tout me dire, je suis ici pour ça et votre problème est pour le moins interessant juridiquement parlant.
Citation :
Comme vous je dirais que les notaires sont parfois médiocres j’ajoute que certains sont de parfait voyous se retranchant derrière le « fameux mot transaction » pour se mettre à couvert.
Comme vous je dirais que les notaires sont parfois médiocres j’ajoute que certains sont de parfait voyous se retranchant derrière le « fameux mot transaction » pour se mettre à couvert.
Durant mes études de droit, on m'a enseigné la garantie des vices cachés en nous expliquant que c'est une garantie fondamentale de protection de l'acquéreur. Cela permet de réparer les mauvaises surprises.
Un jour, de l'aveu même d'un notaire, j'ai appri que les notaires excluaient tout le temps la garantie des vices cachés pour se couvrir au cas où. Bien evidemment, le notaire se tait et l'acquéreur non juriste ne s'en apperçoit pas.
Résultat: Les acquéreurs qui constatent des malfaçons qui ont été maquillées ne peuvent rien faire et cela arrive tous les jours. Justice ou couverture du notaire?
Citation :
Je partage votre opinion sur les avocats( je ne sais si vous en êtes un)
Je partage votre opinion sur les avocats( je ne sais si vous en êtes un)
J'enseigne le Droit civil et le Droit pénal à la Faculté de Droit de montpellier. Position neutre qui me permet au demeurant d'échapper à tout corporatisme!
Citation :
Je vous devais cette explication, excusez la longueur
Je vous devais cette explication, excusez la longueur
Ne vous excusez surtout pas, c'était un plaisir pour moi.
Bien cordialement.
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Monsieur le Professeur,
Je vous confirme que la veuve a bien opté pour un tiers en pleine propriété (deux enfants du de cujus)
Oui Madame a été condamnée à verser une indemnité d’occupation mais pour ne plus y être assujettie elle a vendu le pavillon. ! Le notaire connaissait parfaitement la situation.
J’analyse le fait de l’indemnité d’occupation comme la résultante du choix de la QD en pleine propriété et que Mme n’était plus « propriétaire » du fait de la communauté universelle ?
Le bien a pu être vendu car la transcription du régime n’a pas été faite aux hypothèques lors du mariage. .
Aujourd’hui je ne suis pas certaine que les enfants verront leur par de réserve servi malgré l’hypothèque que jeleur ai fait prendre pour la seule somme que je pouvais justifier, l’indemnité d’occupation. Le notaire refuse de donner les comptes après décès au motif qu’il n’y a pas d’indivision. du fait de l'attribution intégrale!
Je me demande même si le notaire mandaté par le tribunal ne cherche pas à réduire au maximum la part des enfants pour que le notaire, partie à l’acte ne soit pas inquiété. Aujourd’hui je ne m’étonne plus de rien.
Vous êtes professeur à la fac de Montpellier ! Je comprends pourquoi vous connaissez bien la cass civ 1ere du 14/12/2004 paru dans le recueil Dalloz du 24 février 2005 avec note de Rémy CABRILLAC. J’ai posé la même question à son centre de recherche mais pas de réponse. Je frappe à toutes les portes.
A l’époque j’avais même écrit au président ANCEL de la Cour pour lui demander des explications…en vain. J’avais assisté à l’audience en sortant je me suis demandée si l’assemblée avait écouté le rapporteur. ? Il s’agit de l’arret n° 425 F-P+B Pourvoi n° P 03-19-206 du 28 février 2006. Bonne question d’analyse pour vos élèves.
Recevez, monsieur le professeur mes salutations distinguées
Je vous confirme que la veuve a bien opté pour un tiers en pleine propriété (deux enfants du de cujus)
Oui Madame a été condamnée à verser une indemnité d’occupation mais pour ne plus y être assujettie elle a vendu le pavillon. ! Le notaire connaissait parfaitement la situation.
J’analyse le fait de l’indemnité d’occupation comme la résultante du choix de la QD en pleine propriété et que Mme n’était plus « propriétaire » du fait de la communauté universelle ?
Le bien a pu être vendu car la transcription du régime n’a pas été faite aux hypothèques lors du mariage. .
Aujourd’hui je ne suis pas certaine que les enfants verront leur par de réserve servi malgré l’hypothèque que jeleur ai fait prendre pour la seule somme que je pouvais justifier, l’indemnité d’occupation. Le notaire refuse de donner les comptes après décès au motif qu’il n’y a pas d’indivision. du fait de l'attribution intégrale!
Je me demande même si le notaire mandaté par le tribunal ne cherche pas à réduire au maximum la part des enfants pour que le notaire, partie à l’acte ne soit pas inquiété. Aujourd’hui je ne m’étonne plus de rien.
Vous êtes professeur à la fac de Montpellier ! Je comprends pourquoi vous connaissez bien la cass civ 1ere du 14/12/2004 paru dans le recueil Dalloz du 24 février 2005 avec note de Rémy CABRILLAC. J’ai posé la même question à son centre de recherche mais pas de réponse. Je frappe à toutes les portes.
A l’époque j’avais même écrit au président ANCEL de la Cour pour lui demander des explications…en vain. J’avais assisté à l’audience en sortant je me suis demandée si l’assemblée avait écouté le rapporteur. ? Il s’agit de l’arret n° 425 F-P+B Pourvoi n° P 03-19-206 du 28 février 2006. Bonne question d’analyse pour vos élèves.
Recevez, monsieur le professeur mes salutations distinguées
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Bonjour,
Malheureusement, je ne suis pas encore professeur! Je suis enseignant vacataire mais cela ne saurait tarder (j'espère).
Oui, c'est bien ça. J'avais oublié qu'ils avaient opté pour le régime de la communauté universelle. Dans ce cas, selon moi, la maison est en indivision avec la succession.
Il est vrai qu'en principe la communauté universelle avec attribution au dernier survivant a pour effet de supprimer de facto, l'existence d'une indivision successorale.
Mais dans la mesure où les enfants du premier lit disposent de l'action en retranchement qui leur permet de bénéficier de la réserve héréditaire, ils devienent donc héritier en dépit de la clause d'attribution universelle.
Il devrait donc y avoir une indivision successorale.
Promis, j'irai regarder l'arrêt.
Citation :
Monsieur le Professeur,
Monsieur le Professeur,
Malheureusement, je ne suis pas encore professeur! Je suis enseignant vacataire mais cela ne saurait tarder (j'espère).
Citation :
Oui Madame a été condamnée à verser une indemnité d’occupation mais pour ne plus y être assujettie elle a vendu le pavillon. ! Le notaire connaissait parfaitement la situation.
J’analyse le fait de l’indemnité d’occupation comme la résultante du choix de la QD en pleine propriété et que Mme n’était plus « propriétaire » du fait de la communauté universelle ?
Oui Madame a été condamnée à verser une indemnité d’occupation mais pour ne plus y être assujettie elle a vendu le pavillon. ! Le notaire connaissait parfaitement la situation.
J’analyse le fait de l’indemnité d’occupation comme la résultante du choix de la QD en pleine propriété et que Mme n’était plus « propriétaire » du fait de la communauté universelle ?
Oui, c'est bien ça. J'avais oublié qu'ils avaient opté pour le régime de la communauté universelle. Dans ce cas, selon moi, la maison est en indivision avec la succession.
Citation :
Le notaire refuse de donner les comptes après décès au motif qu’il n’y a pas d’indivision. du fait de l'attribution intégrale!
Le notaire refuse de donner les comptes après décès au motif qu’il n’y a pas d’indivision. du fait de l'attribution intégrale!
Il est vrai qu'en principe la communauté universelle avec attribution au dernier survivant a pour effet de supprimer de facto, l'existence d'une indivision successorale.
Mais dans la mesure où les enfants du premier lit disposent de l'action en retranchement qui leur permet de bénéficier de la réserve héréditaire, ils devienent donc héritier en dépit de la clause d'attribution universelle.
Il devrait donc y avoir une indivision successorale.
Citation :
Il s’agit de l’arret n° 425 F-P+B Pourvoi n° P 03-19-206 du 28 février 2006
Il s’agit de l’arret n° 425 F-P+B Pourvoi n° P 03-19-206 du 28 février 2006
Promis, j'irai regarder l'arrêt.
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Monsieur,
Pour alimenter votre réflexion je me permets de vous transmettre l’information suivante recueilli sur capib.com "DÉCÈS de l'assuré :
En cas de décès de l'assuré, le capital restant dû est versé au bénéficiaire c'est à dire à l'organisme prêteur. Les sommes restant dues, dont le remboursement est ainsi garanti par le contrat d'assurance, ne constituent donc pas une dette à la charge du défunt et ne sont donc pas admises en déduction de l'actif successoral pour le calcul des droits de succession. Si vous voulez éviter cela, et que la dette du bien emprunté figure bien au "passif" successoral, et donc diminue le montant des droits de succession, il faut inscrire au contrat une clause dite "Clause séquestre".
La garantie Décès est la garantie principale du contrat et doit être obligatoirement souscrite"
Autrement dit : si les sommes remboursées ne constituent pas une dette de succession, c’est que la succession ne doit pas récompense à la communauté.
Bonsoir
Pour alimenter votre réflexion je me permets de vous transmettre l’information suivante recueilli sur capib.com "DÉCÈS de l'assuré :
En cas de décès de l'assuré, le capital restant dû est versé au bénéficiaire c'est à dire à l'organisme prêteur. Les sommes restant dues, dont le remboursement est ainsi garanti par le contrat d'assurance, ne constituent donc pas une dette à la charge du défunt et ne sont donc pas admises en déduction de l'actif successoral pour le calcul des droits de succession. Si vous voulez éviter cela, et que la dette du bien emprunté figure bien au "passif" successoral, et donc diminue le montant des droits de succession, il faut inscrire au contrat une clause dite "Clause séquestre".
La garantie Décès est la garantie principale du contrat et doit être obligatoirement souscrite"
Autrement dit : si les sommes remboursées ne constituent pas une dette de succession, c’est que la succession ne doit pas récompense à la communauté.
Bonsoir
Posté le Le 18/07/2012 à 03:26
Bonsoir,
Je ne vois pas en quoi cela valide le fait que cette somme ne soit pas un bien commun! En effet, cet article ne fait que dire: "Dans la mesure où l'assurance rembourse le crédit, la dette n'est pas inscrite dans la succession".
C'est normal! Puisque justement l'assurance a remboursé la dette.. CQFD!
Bien cordialement,
Bonne soirée!
Citation :
Les sommes restant dues, dont le remboursement est ainsi garanti par le contrat d'assurance, ne constituent donc pas une dette à la charge du défunt et ne sont donc pas admises en déduction de l'actif successoral pour le calcul des droits de succession.
Les sommes restant dues, dont le remboursement est ainsi garanti par le contrat d'assurance, ne constituent donc pas une dette à la charge du défunt et ne sont donc pas admises en déduction de l'actif successoral pour le calcul des droits de succession.
Je ne vois pas en quoi cela valide le fait que cette somme ne soit pas un bien commun! En effet, cet article ne fait que dire: "Dans la mesure où l'assurance rembourse le crédit, la dette n'est pas inscrite dans la succession".
C'est normal! Puisque justement l'assurance a remboursé la dette.. CQFD!
Bien cordialement,
Bonne soirée!
PAGE : [ 1 ]