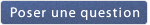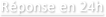Licenciement pour insuffisance professionnelle
Posté le Le 03/08/2025 à 14:15
Vous n'avez pas lu toutes les décisions que vous avez données ( oui, je lis vite ;-) )
Certains ont porté plainte et cela n'a rien donné puisqu'on ne porte pas plainte contre l'état, on a un litige, on fait valoir un préjudice ( l'état ne va pas en prison ;-) )
Et là, on est seulement dans le cadre de litige concernant un emploi, pas dans le cadre de manquement ayant entrainé la mort ou une infirmité ...
Ce pourquoi aussi il y a des situations surréalistes ou des fonctionnaires ne craignent rien, si les sanctionner serait reconnaître la responsabilité de l'état .
Ce pourquoi il y a de graves dysfonctionnement aussi ...
Reste la saisie de la CEDH quand toutes les voies de recours ont été épuisées ( grosso modo 10 ans de procédure jusqu'au conseil d'état dans le contexte)
Le défenseur des droits émet un avis sur une situation discriminatoire , que la justice peut ne pas suivre .
Certains ont porté plainte et cela n'a rien donné puisqu'on ne porte pas plainte contre l'état, on a un litige, on fait valoir un préjudice ( l'état ne va pas en prison ;-) )
Et là, on est seulement dans le cadre de litige concernant un emploi, pas dans le cadre de manquement ayant entrainé la mort ou une infirmité ...
Ce pourquoi aussi il y a des situations surréalistes ou des fonctionnaires ne craignent rien, si les sanctionner serait reconnaître la responsabilité de l'état .
Ce pourquoi il y a de graves dysfonctionnement aussi ...
Reste la saisie de la CEDH quand toutes les voies de recours ont été épuisées ( grosso modo 10 ans de procédure jusqu'au conseil d'état dans le contexte)
Le défenseur des droits émet un avis sur une situation discriminatoire , que la justice peut ne pas suivre .
Posté le Le 03/08/2025 à 14:21
Merci pour votre retour détaillé.
Mon avocat m’a effectivement indiqué que je pouvais faire appel, mais après avoir longuement pesé le pour et le contre, je pense ne pas donner suite à cette option.
Je suis consciente des limites du système, et je réalise que même si j’ai le sentiment d’avoir été injustement traitée, les voies de recours sont très encadrées et ne m’offrent, en l’état, que peu de chances réelles d’obtenir une titularisation ou même une indemnisation.
Je voulais simplement témoigner de la réalité vécue, humaine et professionnelle, derrière ce type de décision.
Le plus difficile, au fond, ce n’est pas seulement la décision administrative, mais l’absence totale de reconnaissance du parcours, des efforts fournis et de l’engagement, même dans un contexte de handicap reconnu.
Merci malgré tout pour le temps que vous prenez à expliquer ces mécanismes, et à partager votre lecture du droit. Cela aide à prendre du recul.
Mon avocat m’a effectivement indiqué que je pouvais faire appel, mais après avoir longuement pesé le pour et le contre, je pense ne pas donner suite à cette option.
Je suis consciente des limites du système, et je réalise que même si j’ai le sentiment d’avoir été injustement traitée, les voies de recours sont très encadrées et ne m’offrent, en l’état, que peu de chances réelles d’obtenir une titularisation ou même une indemnisation.
Je voulais simplement témoigner de la réalité vécue, humaine et professionnelle, derrière ce type de décision.
Le plus difficile, au fond, ce n’est pas seulement la décision administrative, mais l’absence totale de reconnaissance du parcours, des efforts fournis et de l’engagement, même dans un contexte de handicap reconnu.
Merci malgré tout pour le temps que vous prenez à expliquer ces mécanismes, et à partager votre lecture du droit. Cela aide à prendre du recul.
Posté le Le 03/08/2025 à 14:52
A l'intention de kang
les décisions mises en lien n'étaient-elles pas antérieures à l'arrêté du 26 mai 2021 relatif, notamment, aux actes de discrimination dont s'estiment victimes ou sont témoins les agents du service public ?
Or cet arrêté précise bien que les dispositifs interne et externe de signalement (recueil, traitement), prise en charge et suites données à un signalement ne se substituent pas aux autres voies de recours, telles que les réclamations auprès du Défenseur des droits ou les voies légales : article 40 du code de procédure pénale, dépôt de plainte, juge civil, etc.
Que l'employeur soit un directeur d'hôpital public, responsable d'établissement, cela le dégage-t-il de toute responsabilité pénale y compris en tant qu'auteur indirect qui n'aurait pas pris toute mesure pour éviter telle ou telle infraction, même non intentionnelle de sa part ?
Enfin, à propos du dommage, la question serait de savoir s'il n'y a pas préjudice automatique, ou s'il faut au contraire le documenter, dans certains cas où l'employeur a manqué à son obligation / santé et sécurité de l'employé. En ne tenant pas compte par exemple des restrictions émises par le service de médecine préventive, ou en affectant un agent ayant la RQTH, dont l'état de santé est à risque, à des tâches qui l'exposent à un sur-risque...
cdt
les décisions mises en lien n'étaient-elles pas antérieures à l'arrêté du 26 mai 2021 relatif, notamment, aux actes de discrimination dont s'estiment victimes ou sont témoins les agents du service public ?
Or cet arrêté précise bien que les dispositifs interne et externe de signalement (recueil, traitement), prise en charge et suites données à un signalement ne se substituent pas aux autres voies de recours, telles que les réclamations auprès du Défenseur des droits ou les voies légales : article 40 du code de procédure pénale, dépôt de plainte, juge civil, etc.
Que l'employeur soit un directeur d'hôpital public, responsable d'établissement, cela le dégage-t-il de toute responsabilité pénale y compris en tant qu'auteur indirect qui n'aurait pas pris toute mesure pour éviter telle ou telle infraction, même non intentionnelle de sa part ?
Enfin, à propos du dommage, la question serait de savoir s'il n'y a pas préjudice automatique, ou s'il faut au contraire le documenter, dans certains cas où l'employeur a manqué à son obligation / santé et sécurité de l'employé. En ne tenant pas compte par exemple des restrictions émises par le service de médecine préventive, ou en affectant un agent ayant la RQTH, dont l'état de santé est à risque, à des tâches qui l'exposent à un sur-risque...
cdt
Posté le Le 03/08/2025 à 15:18
Absolument rien à voir dans le contexte puisque la contestation ne porte pas sur une discrimination signalée dans le cadre de son travail par les agents en place , mais un refus de titularisation au motif discriminatoire .
Dans les faits,ce signalement oblige seulement à une "enquête" les conclusions étant rarement d'une aide pertinente pour la victime au de là de la reconnaissance d'une lésion psychique dans le cadre d'un indemnisation en CITIS .
Vous voulez qu'elle porte plainte contre son ancienne supérieure ?pourquoi faire ? A quel titre ?
Ce n'est pas la supérieure qui décide de titulariser ( ou pas) : par de là, il n'y a pas discrimination de sa part, puisque ce n'est pas elle, personnellement, qui lui enlève cette possibilité .
C'est l'établissement employeur par la commission administrative paritaire .
Ce pourquoi, c'est bien l'employeur public qui est mis en cause par le biais du TA .
Après si vous nous expliquez que l'avocat de la postante est mauvais au point de ne pas mettre en oeuvre la procédure adéquate... pourquoi pas .
Dans les faits,ce signalement oblige seulement à une "enquête" les conclusions étant rarement d'une aide pertinente pour la victime au de là de la reconnaissance d'une lésion psychique dans le cadre d'un indemnisation en CITIS .
Vous voulez qu'elle porte plainte contre son ancienne supérieure ?pourquoi faire ? A quel titre ?
Ce n'est pas la supérieure qui décide de titulariser ( ou pas) : par de là, il n'y a pas discrimination de sa part, puisque ce n'est pas elle, personnellement, qui lui enlève cette possibilité .
C'est l'établissement employeur par la commission administrative paritaire .
Ce pourquoi, c'est bien l'employeur public qui est mis en cause par le biais du TA .
Après si vous nous expliquez que l'avocat de la postante est mauvais au point de ne pas mettre en oeuvre la procédure adéquate... pourquoi pas .
Posté le Le 03/08/2025 à 15:41
Vous l'aurez sans doute remarqué, je ne faisais que poser des questions, sans prétention incitative aucune sauf peut-être d'examiner différents angles avant que de les refermer.
Voici opportunément un article que j'ai trouvé intéressant, avec au passage la mention aux arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille, 27 novembre 2018 et 18 novembre 2015, ce dernier ayant reconnu un droit à indemnisation du préjudice moral résultant d'un refus illégal de titularisation.
https://www.monexpertisejuridique.fr/la-titularisation-refusee-illegalement-droits-recours-et-strategies-de-defense/
Enfin, est-ce que j'en serais à expliquer, comme vous l'écrivez, que l'avocat de la postante est mauvais... loin de moi l'idée, je note seulement dans l'article en lien que si l'on veut optimiser la stratégie de recours et éviter des erreurs de procédure un avocat spécialisé en droit de la FP est à conseiller, voilà tout.
cdt
Voici opportunément un article que j'ai trouvé intéressant, avec au passage la mention aux arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille, 27 novembre 2018 et 18 novembre 2015, ce dernier ayant reconnu un droit à indemnisation du préjudice moral résultant d'un refus illégal de titularisation.
https://www.monexpertisejuridique.fr/la-titularisation-refusee-illegalement-droits-recours-et-strategies-de-defense/
Enfin, est-ce que j'en serais à expliquer, comme vous l'écrivez, que l'avocat de la postante est mauvais... loin de moi l'idée, je note seulement dans l'article en lien que si l'on veut optimiser la stratégie de recours et éviter des erreurs de procédure un avocat spécialisé en droit de la FP est à conseiller, voilà tout.
cdt
Posté le Le 03/08/2025 à 16:55
Je comprends bien qu’on ne peut pas imputer directement la décision de non-titularisation à une personne, mais bien à l’établissement via les instances comme la CAP.
Il ne s’agit évidemment pas de “porter plainte” contre une supérieure hiérarchique à titre personnel — ce n’est ni le bon cadre, ni le bon fondement. Mon intention n’était pas de désigner un bouc émissaire, mais d’exprimer le sentiment d’injustice quand on travaille un an, sans retour ni encadrement spécifique, dans un service sensible, et qu’ensuite on se voit opposer une appréciation brutale en fin de parcours.
Mon avocat ne m’a pas orientée vers une plainte, mais m’a informée de mes droits de recours, y compris la possibilité d’appel. Mais au vu de tout ce que vous soulignez (et que je constate également), je pense effectivement ne pas aller plus loin. Cela demande une énergie importante, pour très peu de chances de résultat.
Je prends note que le signalement d’une discrimination ne suffit pas à remettre en cause une décision, ni à garantir une réparation, sauf dans un cadre très particulier comme le CITIS. Et je comprends mieux, grâce à vos explications, pourquoi tant de recours échouent même quand les faits vécus sont lourds.
Merci à vous de m’avoir éclairée avec précision, même si cela confirme que la reconnaissance n’est pas toujours au rendez-vous, même quand les faits semblent clairs.
Il ne s’agit évidemment pas de “porter plainte” contre une supérieure hiérarchique à titre personnel — ce n’est ni le bon cadre, ni le bon fondement. Mon intention n’était pas de désigner un bouc émissaire, mais d’exprimer le sentiment d’injustice quand on travaille un an, sans retour ni encadrement spécifique, dans un service sensible, et qu’ensuite on se voit opposer une appréciation brutale en fin de parcours.
Mon avocat ne m’a pas orientée vers une plainte, mais m’a informée de mes droits de recours, y compris la possibilité d’appel. Mais au vu de tout ce que vous soulignez (et que je constate également), je pense effectivement ne pas aller plus loin. Cela demande une énergie importante, pour très peu de chances de résultat.
Je prends note que le signalement d’une discrimination ne suffit pas à remettre en cause une décision, ni à garantir une réparation, sauf dans un cadre très particulier comme le CITIS. Et je comprends mieux, grâce à vos explications, pourquoi tant de recours échouent même quand les faits vécus sont lourds.
Merci à vous de m’avoir éclairée avec précision, même si cela confirme que la reconnaissance n’est pas toujours au rendez-vous, même quand les faits semblent clairs.
Posté le Le 03/08/2025 à 16:58
A l’attention de calete
Les décisions que vous évoquez ne tiennent-elles pas compte d’une période antérieure à l’arrêté du 26 mai 2021, qui encadre désormais clairement le signalement des actes de discrimination au sein de la fonction publique ?
Cet arrêté précise que les dispositifs de signalement (internes et externes), leur traitement et les suites données ne se substituent pas aux autres voies de recours prévues par la loi : article 40 du Code de procédure pénale, dépôt de plainte, action au civil, saisine du Défenseur des droits, etc.
Dans ce contexte, même si la non-titularisation est décidée par une commission, cela n’exonère pas l’établissement employeur, ni ses représentants, de toute responsabilité pénale ou administrative, notamment en cas de manquement à l’obligation de sécurité. Il existe en effet une jurisprudence sur la faute inexcusable de l’employeur, y compris en cas de dommage non intentionnel, si celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de ses agents.
La question du préjudice mérite aussi d’être posée. N’y a-t-il pas préjudice automatique lorsque l’on affecte un agent reconnu RQTH à un service à haut risque (comme un secteur Covid), sans suivi ni aménagement de poste, et en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ? L’obligation de santé-sécurité de l’employeur n’est-elle pas alors engagée ?
Je ne dis pas que cela garantit l’issue d’un recours — loin de là — mais qu’il y a peut-être là matière à réflexion sur les responsabilités indirectes, et sur le cadre légal actuel qui a évolué depuis certaines décisions citées.
Les décisions que vous évoquez ne tiennent-elles pas compte d’une période antérieure à l’arrêté du 26 mai 2021, qui encadre désormais clairement le signalement des actes de discrimination au sein de la fonction publique ?
Cet arrêté précise que les dispositifs de signalement (internes et externes), leur traitement et les suites données ne se substituent pas aux autres voies de recours prévues par la loi : article 40 du Code de procédure pénale, dépôt de plainte, action au civil, saisine du Défenseur des droits, etc.
Dans ce contexte, même si la non-titularisation est décidée par une commission, cela n’exonère pas l’établissement employeur, ni ses représentants, de toute responsabilité pénale ou administrative, notamment en cas de manquement à l’obligation de sécurité. Il existe en effet une jurisprudence sur la faute inexcusable de l’employeur, y compris en cas de dommage non intentionnel, si celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de ses agents.
La question du préjudice mérite aussi d’être posée. N’y a-t-il pas préjudice automatique lorsque l’on affecte un agent reconnu RQTH à un service à haut risque (comme un secteur Covid), sans suivi ni aménagement de poste, et en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ? L’obligation de santé-sécurité de l’employeur n’est-elle pas alors engagée ?
Je ne dis pas que cela garantit l’issue d’un recours — loin de là — mais qu’il y a peut-être là matière à réflexion sur les responsabilités indirectes, et sur le cadre légal actuel qui a évolué depuis certaines décisions citées.
Posté le Le 04/08/2025 à 07:47
Bonjour,
J'indique un lien vers un document de formation sous l'égide de l'Association Nationale pour la Formation du personnel Hospitalier (ANFH - 2023), avec deux interventions intéressantes :
- le statut juridique de la discrimination dans la Fonction Publique Hospitalière (par un avocat en droit public au Barreau de Paris) : pages 20 à 31
- le statut pénal de la discrimination et les sanctions applicables (par une juriste, défenseuse des droits) : pages 34 à 75
A noter à ce sujet, pour que le DDD puisse intervenir en matière pénale il faut qu'en parallèle de la saisine du DDD le réclamant ait introduit une plainte pénale, le DDD peut alors demander au Procureur l'autorisation d'instruire pour pouvoir également enquêter.
Toutefois - ce qui rejoint là un message précédent de Kang - même si le droit pénal de non discrimination semble pouvoir menacer de sanctions lourdes, dans la pratique les poursuites et condamnations pénales sont faibles et la preuve de discrimination dans le domaine de l'emploi est difficile à apporter, en particulier l'intention de discriminer.
https://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/support_journee_regionale_hauts-de-france_lille.pdf
cdt
J'indique un lien vers un document de formation sous l'égide de l'Association Nationale pour la Formation du personnel Hospitalier (ANFH - 2023), avec deux interventions intéressantes :
- le statut juridique de la discrimination dans la Fonction Publique Hospitalière (par un avocat en droit public au Barreau de Paris) : pages 20 à 31
- le statut pénal de la discrimination et les sanctions applicables (par une juriste, défenseuse des droits) : pages 34 à 75
A noter à ce sujet, pour que le DDD puisse intervenir en matière pénale il faut qu'en parallèle de la saisine du DDD le réclamant ait introduit une plainte pénale, le DDD peut alors demander au Procureur l'autorisation d'instruire pour pouvoir également enquêter.
Toutefois - ce qui rejoint là un message précédent de Kang - même si le droit pénal de non discrimination semble pouvoir menacer de sanctions lourdes, dans la pratique les poursuites et condamnations pénales sont faibles et la preuve de discrimination dans le domaine de l'emploi est difficile à apporter, en particulier l'intention de discriminer.
https://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/support_journee_regionale_hauts-de-france_lille.pdf
cdt
PAGES : [ 1 ] [ 2 ]